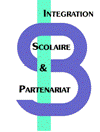|
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page6.htm LES RÈGLES DU JEU DU PARTENARIAT des
compétences pour le système |
|||||||||
"Les
animaux qui n'ont pas de squelette s'entourent d'une carapace" R.P. Sertillanges, O.P. |
|||||||||
| Introduction | |||||||||
| L'idée directrice, concernant le fonctionnement du partenariat dans l'ensemble du système de prise en charge des enfants handicapés, et concernant plus particulièrement les rapports du couple instituteur-éducateur, nous l'emprunterons à Michel Crozier. Dans "L'acteur et le système", ouvrage paru en 1977 et qui demeure encore aujourd'hui une référence majeure pour l'analyse des "contraintes de l'action collective", Michel Crozier, analysant la nature et les difficultés de celle-ci, édicte une règle capitale, simple et pragmatique, et extrêmement éclairante : il faut, dit-il des fonctions pour le système et des objectifs pour les acteurs. | |||||||||
| Cette maxime est appelée à être le "fil rouge" des réflexions que dans ce site nous consacrerons aux règles du jeu du partenariat. Le concept de "règles du jeu" est également emprunté à Michel Crozier (1) : il exprime que le construit social est structuré, - et sous cet angle il est un contenant qui impose à chacun des acteurs ses mécanismes et sa cohérence, - mais que son fonctionnement, sa régulation, et donc finalement son évolution, reposent aussi largement sur le comportement des acteurs, sur les stratégies qu'ils développent et sur les rapports qu'ils établissent entre eux. (Crozier, p. 78-86). | |||||||||
| (1) Si cette maxime ne se trouve pas littéralement dans le livre de Michel Crozier, elle en exprime tout à fait l'esprit. Voir A. Guillotte, Rémi Fauvernier et Jean-Marie Froidevaux, "Psychologie scolaire : laboratoire de la psychologie clinique", in Psychologie & éducation, n° 9, juin/juill. 92. | |||||||||
| 1. Des compétences pour le système | |||||||||
| La scolarisation des enfants nécessitant des soins d'ordre psychiatrique, médical ou paramédical, exige, nul ne le contestera, que soient réunies des fonctions et des compétences diverses, relevant du champ de la scolarisation et du champ de la santé. Nous utilisons à dessein deux termes - fonctions et compétences - qui se recoupent pour une part et s'éclairent mutuellement. La fonction est ce que doit accomplir une personne pour jouer son rôle dans un groupe social, c'est à la fois son rôle et son action. Le système (2) est donc essentiellement constitué de l'ensemble des fonctions dont il s'est doté en vue d'accomplir sa mission, et il appartient à ceux qui occupent dans le système un poste de responsabilité d'organiser ces fonctions pour autant qu'elles dépendent d'eux. C'est leur responsabilité propre. Mais ces fonctions sont inséparables d'un certain nombre de moyens, de règles, de dispositifs ou de dispositions, qui permettent précisément aux uns et aux autres de les exercer (3). Cet ensemble représente la tâche normale des administrations et des institutions, quand elles font leur travail (4)... C'est ce que nous appelons les compétences du système, au sens large qu'on utilise volontiers aujourd'hui (5). | |||||||||
| Le terme de compétences, plus englobant que celui de fonction, présente de plus l'intérêt de posséder deux sens, qu'on souhaite voir le plus souvent associés dans les faits. Il désigne en effet d'une part l'aptitude reconnue légalement à une personne de faire tel ou tel acte dans des conditions déterminées, par exemple occuper tel poste ou exercer telle fonction, et d'autre part la capacité personnelle de l'individu à bien tenir son poste. Le bon sens et une exigence d'ordre déontologique voudraient qu'on trouvat sur tous les postes, à tous les niveaux, des personnels compétents à ces deux titres, c'est à dire de par leur statut mais aussi de par leurs qualités personnelles et leur qualification professionnelle (6). | |||||||||
| 2) Système, c'est à dire "ensemble d'institutions, de pratiques, de méthodes formant à la fois une construction théorique et une méthode pratique..." (Le Grand Robert). Voir aussi M.Crozier (encadré). | |||||||||
| (3) et qui sont aussi, pour une part, le résultat de l'action des acteurs. Le système est par nature évolutif, malgré ses pesanteurs, et les textes, comme les dispositifs, sont le plus souvent la conséquence et le fruit des initiatives qui les ont précédés. | |||||||||
| (4) Voir par exemple, dans ce site, l'organigramme d'une CLIS à caractère thérapeutique, élément partiel de ce que pourrait être l'organigramme général de la scolarisation des enfants handicapés. (Ex : clis de l'école Descartes/organigramme). | |||||||||
| (5) par exemple quand on parle d'un pôle de compétences. Le terme de "compétence" a déjà largement concurrencé celui de "qualification professionnelle"... | |||||||||
| (6) Faut-il insister par exemple sur la nécessité que soient nommés, sur des postes délicats comme ceux de professeurs des écoles ou d'éducateurs spécialisés auprès d'enfants handicapés ou dysharmoniques, des personnels qualifiés, formés, et si possible motivés ? | |||||||||
| 2. Des objectifs pour les acteurs | |||||||||
| Les éléments du jeu étant en place, et les rè́gles établies, encore faut-il prendre en compte le comportement des joueurs, qui a sa rationalité propre. Nous ne sommes pas structuralistes au point de penser que les rè́gles suffiraient à déterminer leurs motivations, leurs rapports et leurs stratégies. Les rè́gles sont une condition du jeu, mais elles ne suffisent pas à́ rendre compte de son déroulement (7). | |||||||||
| Observons en effet que les fonctions et les compétences, qu'il s'agisse des compétences administratives reconnues en droit é chacune des institutions ou des compétences professionnelles propres é chacun des acteurs, en méme temps qu'elles définissent la place et le réle des uns et des autres, sont aussi ce qui les différencie. Ce n'est pas ce qui fonde un partenariat. | |||||||||
| Il arrive méme que certains se retranchent derriére la définition de leur fonction pour ne pas s'engager réellement dans le sens du partenariat. Si les acteurs, sur le terrain, ont l'obsession de se démarquer les uns des autres en opposant leurs compétences, et de s'enfermer dans un réle qu'ils définiraient chacun exclusivement par son statut professionnel propre, il n'est plus possible de travailler ensemble. On reste au mieux les uns é cété des autres... (8). | |||||||||
| Il reste donc é construire le partenariat sur le terrain, ou plutét les partenariats, car les formes en seront diverses selon les situations, selon les personnes et selon les objectifs poursuivis. (9) | |||||||||
| Or ce qui fonde un partenariat, ce sont évidemment les objectifs que l'on veut atteindre ensemble, et la maniére dont chacun met ses compétences propres au service de l'objectif commun. Les objectifs deviennent prioritaires. Un véritable partenariat, respectueux de la liberté et de la compétence propre de chacun des partenaires, exige fondamentalement des objectifs sinon communs, du moins partagés. Ce sont par exemple, au niveau des institutions, les objectifs que l'on s'est donnés en créant la classe, et qui figurent sans doute dans la convention qu'on a signée et, sur le terrain, les objectifs sur lesquels on est d'accord pour la classe et pour chacun des enfants. Ces objectifs, qu'on s'efforce le plus souvent d'expliciter en différents projets, - projets individuels ou projets de classe, par exemple, - fondent l'unité du travail. Il importe de préciser, - d'"objectiver" - les résultats que l'on se propose d'atteindre avant de se répartir les actions susceptibles d'y contribuer ! | |||||||||
| Nous avons précisé, fidéle encore é Michel Crozier, objectifs partagés, de préférence é objectifs communs, pour marquer qu'il n'y a pas confusion des réles. Mais si la scolarisation et le parcours scolaire de chaque enfant n'intéressent que l'instituteur, et si sa santé psychique n'intéresse que l'éducateur spécialisé et le médecin, il est clair qu'il n'y a plus de collaboration possible. Chacun ne doit pas tout faire, mais chacun doit s'intéresser é l'enfant, é tout l'enfant, ou comme on disait jadis, é l'éléve et é la personne. | |||||||||
| Mais cette notion d'objectifs - communs ou partagés - n'est jamais vécue de maniére simple, car chacun des intervenants poursuit en réalité des objectifs multiples et complexes. Et si les fonctions appartiennent au systéme, on peut dire que les stratégies opérationnelles qui doivent permettre d'atteindre les objectifs appartiennent, d'une certaine maniére, aux acteurs. qui certes poursuivent des objectifs partagés mais qui poursuivent aussi des objectifs personnels. La liberté des acteurs reste réelle, d'autant que "les décideurs ne savent jamais trés bien ce qu'ils veulent", au moins au départ (10). Chacun agit aussi en fonction de ses intéréts propres, et notamment de son degré d'investissement personnel dans son travail, avec ce que les décalages entre les acteurs peuvent ajouter de difficulté é leur collaboration. | |||||||||
| Ce concept d'objectifs partagés méritera donc une attention particuliére de notre part. Il n'en reste pas moins que sur le terrain, ce qui est essentiel, ce qui rend le travail cohérent, ce qui créée la confiance réciproque, c'est qu'on soit responsable ensemble du devenir des enfants, et dans le cas précis qui nous occupe, responsable ensemble de le bonne intégration scolaire.. | |||||||||
| (7) Imaginons que l'un des partenaires participe é contre-coeur, ou avec l'intention de perdre...Imaginons sur le terrain de foot des joueurs qui traénent des pieds... | |||||||||
| (8) Le fameux secret professionnel, par exemple, combien de fois n'a-t-il pas servi d'alibi é un refus de collaboration : on veut bien travailler ensemble, mais sans véritable engagement réciproque... Le fait d'ailleurs qu'il ne fasse plus guére probléme aujourd'hui dans les rapports éducation nationale/Santé est l'un des signes des progrés de la collaboration entre les personnels des deux secteurs, qui se connaissant mieux, savent ce que chacun peut attendre de l'autre... | |||||||||
| (9) Le partenariat ne prendra pas les mémes formes, par exemple, en CLIS ou en Institut de Rééducation... | |||||||||
| (10) M. Crozier. Voir encadré ci-dessous. | |||||||||
| (11) Nous avons retenu cette phrase d'un document émanant du CNEFEI, dont nous avons perdu la référence. | |||||||||
| (12) J'ai eu parfois le sentiment que des personnels spécialisés qui disaient ne pas vouloir entrer dans les écoles, manquaient d'abord de confiance en eux-mémes... Nous avons connu un SESSAD qui s'était donné, é ses débuts, un lieu d'accueil en face de l'école : l'éducateur et l'orthophoniste craignaient sans doute de ne pas étre reconnus dans leur compétence professionnelle s'ils intervenaient dans l'école. Et sans doute de méme les instituteurs qui refuseraient la présence d'un éducateur dans leur classe... C'est ainsi qu'on en vient, si les identités ne sont pas assurées, é marquer des domaines, é borner des terrains d'action, é construire des défenses, é se démarquer les uns des autres en opposant des fonctions, que chacun définit comme exclusives... | |||||||||
| (13) Exemple de mépris des compétences professionnelles : déclarer qu'un auxiliaire d'intégration ferait aussi bien le travail de l'éducateur... | |||||||||
| (14) Aprés que la CLIS médico-psychologique de l'école Lavoisier - présentée dans ce site - ait été ouverte, c'est aprés un trimestre de présence dans la classe que l'éducateur a déclaré : "j'ai compris qu'instituteur, c'était un métier". Et l'institutrice avait compris qu'étre éducateur spécialisé, c'était aussi un métier. Ce jour lé, l'Inspecteur a compris é quel point ils avaient craint de ne pas savoir se situer l'un par rapport é l'autre. Et il a compris aussi que c'était gagné. | |||||||||
Pierre Baligand - avril 2002 |
|||||||||
Mise
à jour : 25/09/06
|
|||||||||