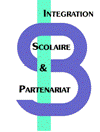nous écrire
|
présentation | |||||||
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page76.htm
clis/sessad et clis/médico-psychologique : une innovation ? les
sessad, l'intersecteur
de psychiatrie infanto-juvénile
| |||||||
La prise en charge par le sessad n'implique pas un type de scolarité : les enfants ou les jeunes concernés peuvent suivre un enseignement ordinaire - en maternelle, en élémentaire, en collège - ou fréquenter une classe spécialisée - clis, upi, ou segpa -. Les orientations en sessad sont individuelles, et les interventions du sessad s'organisent, comme nous l'avons vu, autour du projet individuel de l'élève. Il n'est pas nécessaire - mais rien n'interdit non plus - qu'un sessad suive plusieurs enfants d'une même classe. | |||||||
| Cette seconde partie de notre chapitre va précisément traiter de cette modalité particulière de l'intégration scolaire que constituent les clis/sessad ou les upi/sessad, ou encore les clis/médico-psychologiques, que dans le contexte actuel nous considérons comme des outils privilégiés de l'intégration scolaire (1) et que notre site s'efforce de mettre en valeur. Ces expressions sont pour nous une manière commode de désigner des classes dont tous les enfants sont suivis par un même sessad ou par un même intersecteur de pédopsychiatrie. L'expression indique bien qu'il s'agit de structures fondamentalement partenariales, et que cette action partenariale s'exerce non seulement auprès de chaque individu - commes les interventions habituelles des sessad, - mais aussi auprès du groupe classe comme tel. Ce qui fait leur originalité. Nous en montrons l'intérêt dans les témoignages présentés dans le site, ainsi que dans la page consacrée aux clis. Nous sommes convaincus que cette forme de collaboration favorise le développement qualitatif de l'intégration scolaire, par la place donnée au partenariat, et aussi son développement quantitatif, puisqu'elle concerne des enfants et des adolescents que leur handicap ou leurs troubles conduisent le plus souvent en établissement spécialisé. | |||||||
| (1) Nous préférons les expression de "clis/sessad" et d'"upi/sessad" à celles de "sessad/clis" ou de "sessad/upi", car les termes de clis et upi désignent des groupes d'enfants à l'effectif limité par définition, alors que rien n'indique qu'un sessad devrait se limiter au nombre d'enfants et à cette forme de travail que constitue la clis/sessad ! Mais rien n'empêche bien sûr de créer un sessad qui aurait notamment pour mission de travailler avec une clis ! | |||||||
Le partenariat clis, upi / service de soins dans les textes officiels Une question qui se pose est de savoir si cette forme de partenariat constituerait une aberration, parce qu'elle irait à l'encontre des textes (2), ou si elle peut être au contraire considérée comme conforme à l'esprit des textes et - modérément - innovante (3). Notre réponse est que clis/sessad et upi/sessad s'inscrivent de manière innovante dans la tradition de l'intégration scolaire et qu'en fait, la clis/sessad se dessinait déjà en filigrane dans un certain nombre de textes et de réalisations. | |||||||
| (2) Ce reproche a été fait. | |||||||
| (3)
Innover, ce n'est pas nécessairement procéder à une création
ex nihilo, mais c'est introduire du nouveau dans l'existant, une nouvelle manière
de présenter, d'utiliser, de faire fonctionner des éléments
qui ne sont pas nécessairement radicalement nouveaux en eux-mêmes.
La notion d'innovation comporte par ailleurs une connotation positive. L'innovation
ne mérite son nom que si elle apporte une amélioration, un plus.
Si elle répond à un besoin ou anticipe sur un besoin. Il en est de même pour les textes officiels : une bonne circulaire n'est pas celle qui nait un jour par génération spontanée dans un cabinet ministériel, fut-elle pleine de bonnes intentions... Un bon texte par contre peut conforter une innovation en l'officialisant, et la régulant et finalement en la banalisant. La plupart des bons textes sur l'intégration sont nés ainsi de la prise en compte de réalisations "innovées" par les uns ou les autres, pour répondre à des besoins. La circulaire de 95 sur les upi venait à point, par exemple, pour entériner les premières classes d'intégration en collège ouvertes dans le prolongement naturel des clis... | |||||||
| Nous observerons d'abord que les clis et les sessad existent l'un et l'autre, et indépendamment l'un de l'autre, d'une part, et que les textes officiels ne manquent pas de préconiser leur collaboration, d'autre part. Mais dans ces textes, que nous nous proposons de revisiter, cette collaboration reste à première lecture exclusivement centrée sur l'enfant individuellement. L'innovation, si innovation il y a, résiderait dans le fait de poser le principe d'une classe dont tous les enfants seraient affectés au même sessad (ou au même service), dans le cadre non seulement des projets d'intégration individuels, mais d'une convention globale. | |||||||
a) Les circulaires du 27 avril 95 et du 8 mars 05 relatives à la prise en charge des enfants et adolescents autistes | |||||||
La
première approche
explicite à cet égard, dans les textes réglementaires, se
trouvait sans doute dans la circulaire du 27
avril 95 relative à la prise en charge des enfants autistes. Cette
circulaire, qui constatait (et regrettait ?) que pour les enfants et adolescents
autistes, "le recours aux classes d'enseignement général
ou adapté (CLIS et SES) (4) est très rarement utilisé pour
ces catégories de personnes" (...) demandait très expressément
que les plans d'action régionaux sur l'autisme qu'elle annonçait
promeuvent "une organisation en réseaux (...) entre les divers
services et institutions concernés, qu'ils relèvent du champ sanitaire,
du domaine pédagogique ou du secteur médico-social." (Titre
2, 1, 4°). | |||||||
| (4) On est en 1995, avant la mise en place des CLIS et des UPI... | |||||||
La
circulaire observait que la prise en charge des enfants
autistes de 3 à 12 ans, qui devrait intégrer une triple composante
thérapeutique, pédagogique et éducative, pouvait s'effectuer | |||||||
| (5) Voir Textes officiels. Cette circ. invite les responsables du secteur sanitaire à s'inspirer des textes et des structures du secteur médico-éducatif. Cette circ. est l'un des textes qui fondent administrativement la la clis/médico-psychologique de l'école Lavoisier présentée dans ce site à la page "Troubles dysharmoniques et scolarisation". | |||||||
| La circulaire évoque bien des classes. Elle reconnaît effectivement comme une forme possible de travail avec les enfants autistes un partenariat s'exerçant non seulement auprès de chacun d'eux, individuellement, mais aussi au niveau du groupe classe. Le groupe classe, en effet, en l'occurrence la clis, n'est pas seulement une juxtaposition d'individus, et les phénomènes relationnels et groupaux doivent également être pris en compte dans le cadre du soutien à l'intégration scolaire. Nous ne trahissons pas la circulaire en pensant que les propositions pour la prise en charge des enfants autistes invitent à réaliser une liaison institutionnelle, - par convention, - entre l'intersecteur de pédopsychiatrie ou le sessad, d'une part, et la clis, de l'autre. Et ces propositions sont de bon sens. Comment imaginer qu'un enseignant pourrait travailler seul, ou sans soutien d'ordre médical et paramédical, c'est à dire psychiatrique et éducatif, auprès d'un public d'enfants autistes ? (6). | |||||||
| (6) Deux des classes présentées dans le site correspondent à ces propositions : la clis/sessad de l'école Paul Michaud de Châtelaillon, qui accueille des enfants souffrant de troubles envahissants du développement en partenariat avec un sessad qui possède l'agrément correspondant, et la clis/médico-psychologique de l'école Lavoisier de La Rochelle, qui reçoit des enfants souffrant de troubles dysharmoniques en partenariat avec l'intersecteur de pédopsychiatrie de La Rochelle. Voir Autisme et scolarisation", "Troubles dysharmoniques et scolarisation". | |||||||
| L'approche de la circulaire du 8 mars 05 est un peu différente. Cette circulaire insiste sur la nécessité - et la difficulté - de faire exister un groupe classe : | |||||||
| Circ.
du 8 mars 05 - II3-1)b) Les manifestations de ce syndrome sont en effet particulièrement difficiles à concilier avec l’exercice de l’enseignement qui s’effectue toujours dans un cadre collectif et qui repose, pour une large part, sur les interactions que nouent les élèves au sein de la classe. |
|||||||
| Les conditions d’un accompagnement approprié par des équipes médico-sociales, et/ou des équipes de soins doivent être détermonées en conséquence | |||||||
| Circ.
du 8 mars 05 - II3-1)c) Il s'agit ici de (...) déterminer, en lien étroit avec ces services assurant l’accompagnement, les besoins de création de dispositifs collectifs (CLIS, UPI) organisés pour répondre de façon adaptée aux besoins particuliers qui peuvent être ceux de jeunes présentant des TED (...) |
|||||||
| b) les circulaires sur les UPI | |||||||
| la première circulaire, du 17 mai 95 |
| ||||||
| Le glissement de la clis à l'upi semble assez naturel... Mais les textes sur les upi ne concernent pas seulement les adolescents autistes. | |||||||
| La première circulaire relative aux UPI, du 17mai 95, précisait que "tous les élèves inscrits dans une UPI sont orientés vers le SESSAD ayant signé une convention avec l'établissement d'accueil pour le suivi de leur intégration en liaison étroite avec les autorités administratives du collège et l'équipe éducative élargie, et/ou pour des prises en charges particulières prévues dans le projet personnalisé d'intégration de chaque jeune." (Titre 3). | |||||||
| La circulaire marquait ainsi une avancée très nette dans le sens de l'upi/sessad, c'est à dire dans le sens d'un travail collectif réalisé avec le sessad, ce qui n'étonne pas quand on a constaté l'importance qu'elle accordait, avec raison, à la constitution du groupe-classe : "L'appartenance à un groupe fonctionnant dans le cadre de vie d'un collège, observe-t-elle par ailleurs, la participation aux activités prévues pour ce groupe, (...) sont et doivent demeurer pour ces élèves des facteurs favorisant tant les apprentissages scolaires que l'accession à un meilleur degré d'autonomie." (2.2). | |||||||
Les auteurs de ce texte avaient compris que le plus souvent la première difficulté que l'on rencontre avec des adolescents consiste précisément à les amener à vivre le groupe d'une manière positive. Et si le partenariat ne prend pas en compte le groupe, s'il ne se donne pas parmi ses objectifs de favoriser la vie groupale et l'insertion des individus dans le groupe, à quoi sert-il ? Mais pour cela, il faut assurément que tous les élèves du groupe soient suivis par le même service d'aide. La seconde circulaire, du 21 février 01 | |||||||
| La seconde circulaire sur les upi, en date du 21 février 2001, ne désavoue pas la précédente, dont nous avons souligné l'intérêt, même si elle l'abroge administrativement. Mais son objectif est autre : il est en fait d'inciter vigoureusement au développement des upi, fût-ce sans attendre la mise en place (trop lente ?) des sessad. Désireuse de les voir accueillir un large public, mais en évitant les effets de filières ségrégatives (41), elle fait porter l'accent sur les liens de solidarité entre l'ensemble des élèves d'une classe d'âge... | |||||||
| Cette seconde circulaire ouvre les UPI "au bénéfice d'élèves présentant des déficiences sensorielles ou motrices", sans éprouver le besoin de définir différentes catégories d'UPI, mais en demandant que le fonctionnement de ces UPI soit adapté aux particularités de chaque déficience et qu'elles travaillent "en lien étroit avec les services d'éducation ou de soins ou avec les personnels médicaux et paramédicaux exerçant en libéral qui assurent l'accompagnement dans un cadre formalisé par la signature d'une convention." | |||||||
| Dans sa dernière partie, en revanche, consacrée "aux élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives" c'est à dire aux élèves susceptibles d'être les plus concernés par la formule upi/sessad ou upi/médico-psychologique, cette seconde circulaire revient au principe d'"un groupe classe" dont l'effectif ne peut excéder 10 élèves et placé sous la responsabilité d'un enseignant du premier degré spécialisé... Mais elle n'impose pas la collaboration avec un sessad. (Titre3, 2,2). | |||||||
| Il est vraisemblable que l'une des raisons de la prudence de la circulaire sur ce dernier point tient au fait que l'éducation nationale ne voudrait pas que l'attente de l'ouverture d'un sessad empêche ou retarde celle de l'upi. | |||||||
| c) les circulaires sur les CLIS, des 18 novembre 91 et 30 avril 02 | |||||||
| La circulaire relative aux CLIS du 18 novembre 91, marquait une nouvelle étape dans la scolarisation des enfants en difficulté et des enfants handicapés. Elle mettait fin à l'orientation des élèves simplement "en difficulté" en classe spécialisée, en l'occurrence en classe de perfectionnement (7) ; et elle promouvait l'intégration scolaire des élèves handicapés par la mise en place des CLIS (classes d'intégration scolaire), destinées à des enfants "qui ne peuvent dans l'immédiat être accueillis dans une classe ordinaire et pour lesquels l'admission dans un établissement spécialisé ne s'impose pas" (2/3). (8) | |||||||
| (7) La circulaire,préconisait leur retour dans les classes ordinaires, retour facilité par l'application de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 et par l'aide apportée par les réseaux d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. | |||||||
| (8) Les références données dans cette partie renvoient à la circulaire relative aux clis du 18 nov. 91. | |||||||
| Il n'est pas inintéressant, dans la perspective qui est la nôtre, de relire cette circulaire en nous interrogeant sur l'importance qu'elle accorde à la classe en tant que groupe de vie et d'apprentissage, et en recherchant quelle prise elle donne - ou ne donne pas - à une prise en charge du groupe comme tel dans le cadre du partenariat. Ou, en d'autres termes, cette circulaire se préoccupe-t-elle de la constitution de la classe ? | |||||||
| La circulaire, bien entendu, met d'abord en avant la nécessité d'une "approche individualisée" de chacun des enfants, concrétisée dans un indispensable projet pour chaque élève (2.5). En clis plus encore qu'ailleurs, les objectifs et les démarches pédagogiques doivent être réfléchis en fonction des possibilités et des difficultés de chacun d'eux : la clis, est-il écrit, propose à l'enfant handicapé un enseignement adapté lui permettant "de révéler et d'affirmer ses capacités dans les domaines des savoirs et des savoir-faire"(2.2). | |||||||
| Les clis sont une structure d'intégration scolaire. La circulaire insiste sur l'intérêt de l'implantation de la clis dans une école ordinaire, et sur les bénéfices que les élèves peuvent en attendre : "L'appartenance à un groupe d'élèves stables fonctionnant dans le cadre de vie d'une école ordinaire, la participation (...) à la vie quotidienne des écoliers sont, pour ces élèves, des facteurs d'apprentissage, de scolarisation et d'autonomie." (2.3) (9). | |||||||
| (9) Une attention particulière est accordée aux élèves pris en charge par un service spécialisé : "Pour eux (...) on peut attendre de l'intégration en milieu scolaire ordinaire assurée par la CLIS (...) de nouveaux progrès d'ordre cognitif, dans l'acquisition des compétences scolaires, dans les domaines de l'affectivité, de la socialisation et de l'autonomie "(...) (2.3). Et la circulaire rappelle, les concernant, que "lorsque certains élèves de la CLIS doivent bénéficier, à l'école, de l'action éducative, rééducative ou thérapeutique d'intervenants extérieurs relevant d'un établissement ou d'un service d'éducation spéciale ou du secteur de psychiatrie infanto-juvénile, les modalités de ces actions sont précisées par des procédures conventionnelles (...)" (5). | |||||||
| Concernant le groupe classe, le maître est invité à lui accorder une attention particulière. Il lui est demandé d'instituer pour sa classe un projet pédagogique adapté (2.4), - exigence justifiée pour une classe qui doit adapter les programmes scolaires ordinaires de l'école, - et notamment, et avec une insistance certaine, de favoriser l'expression, d'instaurer et d'organiser la communication, de réguler les échanges, d'organiser les modalités collectives du travail scolaire, bref, d'utiliser la dynamique du groupe d'élèves : l'utilisation des ressources du groupe d'enfants est fondamental.(3.1). "Cet aspect des apprentissages, souvent sous-estimé, est-il encore écrit, doit prendre toute son importance lorsqu'il s'agit d'élèves handicapés" (3.1). | |||||||
| La circulaire n'hésite pas à pointer ici la spécificité pédagogique de la clis qui d'une part organise un enseignement adapté et "d'autre part, s'appuyant sur la dynamique de l'activité de ce groupe d'enfants,(...) fait émerger le sentiment d'appartenance et favorise pour l'élève la prise de conscience de son identité et de ses capacités d'appropriation des compétences de l'écolier" (2.4). | |||||||
| Toutes les actions en ce sens, la circulaire le rappelle, relèvent de la compétence du maître (3/1), - qui de toute façon est toujours responsable de la totalité de ce qui se passe dans sa classe, même lorsque certaines activités sont conduites par d'autres intervenants. Mais la question reste ouverte de savoir si d'autres intervenants peuvent contribuer, avec leurs compétences propres, à la structuration d'un groupe cohérent et favoriser l'émergence de la dynamique du groupe, si bénéfique aux élèves. On semble souvent penser, dans l'éducation nationale, que la constitution d'un groupe classe unifié et porteur des apprentissages va de soi, comme si l'on avait à faire à des élèves naturellement désireux de travailler et d'apprendre ensemble. Mais n'est-ce pas supposer le problème résolu ? Et si le document officiel sur les clis s'attache si résolument à souligner cet aspect collectif du travail, ne serait-ce pas justement parce que ses auteurs n'ignoraient pas les difficultés de l'entreprise ? | |||||||
| S'appuyer sur la dynamique du groupe, certes ! Mais d'abord, susciter cette dynamique... Les témoignages rapportées dans ce site sont particulièrement significatifs, nous semble-t-il, des efforts à développer et des techniques éducatives à mettre en place pour approcher cet objectif (10 Des enfants ou des jeunes souffrant d'autisme, de retard mental, de troubles de la personnalité ne posent pas les mêmes problèmes. Les uns ignorent l'autre, les autres en ont peur et se montrent agressifs... Dans tous les cas, le pédagogue seul reste trop souvent démuni : mais les domaines de l'affectivité, de la socialisation, de l'autonomie, de la psychologie groupale, qui sont ici en jeu, sont-ils le monopole du maître ou peuvent-ils être partagés, y compris durant le temps scolaire, avec un éducateur spécialisé ? | |||||||
| (10) Voir les comptes rendus des personnels qui ont bien voulu faire partager leur expérience : retard mental et scolarisation, institutrice et éducatrice, une éducatrice dans la classe... | |||||||
| Cet aspect de la scolarisation des enfants handicapés, sur lequel la circulaire fait porter l'accent, est fondamental. La possibilité de scolariser certains enfants dans les structures d'intégration collective dépend de la manière dont on l'aura pris en compte et assumé, - fût-ce de manière innovante ! - Nous sommes convaincus en tout cas, - conviction étayée par l'expérience - qu'il ne doit pas être renvoyé à la responsabilité exclusive de l'enseignant mais qu'il doit au contraire entrer dans le champ et faire l'objet de la collaboration partenariale. | |||||||
| La circulaire du 30 avril 02 met davantage l'accent sur l'intégration de la clis et de ses élèves dans l'école. Elle n'en souligne pas moins "la nécessité d'attacher une attention particulière à la composition de chaque classe de manière à assurer la compatibilité des projets individualisés avec le fonctionnement collectif du groupe. La constitution du groupe doit impérativement être effectuée en ayant le souci d'un projet pédagogique cohérent, condition indispensable de progrès pour les élèves." | |||||||
| La circulaire insiste aussi pour que le travail effectué dans les CLIS soit soutenu par l'action des établissements ou services sanitaires ou médico-éducatifs. | |||||||
Note sur l'intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile et les classes d'intégration scolaire
| |||||||
Dans la fidélité au principe de base de l'intégration, à savoir que l'enfant handicapé a droit à l'éducation et qu'il a droit aux soins, les SESSAD sont donc devenus, dans le secteur médico-éducatif, l'outil privilégié de l'intégration. L'orientation des enfants est prononcée par la CDES à titre individuel, comme il se doit, mais on peut également concevoir de construire avec un SESSAD, pour répondre à des besoins spécifiques, une CLIS particulière dont tous les élèves sont affectés à ce service et sont suivis par lui. Un fonctionnement analogue est également réalisable avec les services de pédopsychiatrie. Nous en avons donné des exemples (11). | |||||||
| (11) Voir la partie "expériences" de ce site. Trois de ces clis ont également fait l'objet d'un film vidéo. | |||||||
| On retrouve les mêmes caractéristiques essentielles dans les clis/sessad et dans les clis/medico-psychologiques, et le même intérêt d'un travail au niveau du groupe classe. Un éducateur est présent dans la classe. La rénumération de cet éducateur, dans la clis/sessad, est assurée par le fait que tous les enfants de la CLIS sont affectés au SESSAD. (Le prix de revient d'un sessad travaillant auprès d'une clis/sessad est en principe moins élevé que celui d'un sessad ordinaire dans la mesure notamment où les frais de déplacement des intervenants se trouvent considérablement réduits : voir la page "prix de journée"). | |||||||
| Les témoignages des différents intervenants - renvoyons encore une fois aux exemples présentés dans le site, - conduisent à penser que pour les enfants, le fait que l'éducateur soit présent dans la classe et intervienne aussi au niveau du groupe, contribue aussi à fédérer le groupe et à construire le sentiment d'appartenance à la classe. Le fait que les observations sur la vie de la classe et que les problèmes de la vie groupale puissent être réfléchis en équipe, au cours des réunions de concertation ou de synthèse, avec la participation du médecin du sessad ou de l'intersecteur et celle des différents intervenants, paraît être un atout formidable pour progresser dans les pédagogies éducatives qui permettront d'apprendre à des enfants qui n'y sont pas prêts, à vivre et à travailler ensemble. | |||||||
| Ajoutons que nos propos n'expriment en aucune manière un vœu de voir toutes les clis transformées en classe de cette sorte ! mais ils invitent à saisir à bon escient cette opportunité. La circulaire sur les clis leur assigne une mission d'intégration dans le prolongement des objectifs de l'établissement spécialisé. La clis/sessad et la clis/médico-psychologique restent effectivement encore proches, en un sens, de l'établissement spécialisé ou de l'hôpital de jour, et peuvent paraître encore relativement contraignantes. Elles n'en constituent pas moins, pour certains enfants, le moyen de "limiter les effets ségrégatifs qui peuvent découler d'un placement spécialisé" (Circ. clis, 2.3). | |||||||
Mise
à jour : 27/06/05
| |||||||